Je ne sais pas si j’ai dépassé le pire de la crise avec ce burn-out. On verra bien. Ce qui est sûr par contre, c’est que vers fin juillet, quand la tête et le corps ont lâché en même temps, il s’est passé un truc.
J’avais envie d’écrire et de dessiner, mais mon cerveau refusait absolument de se concentrer sur quoi que ce soit. Pour ne rien arranger à cela, dans le but de calmer les angoisses dans l’immédiat, je me suis remis à fumer ces douces herbes qui rendent les choses plus légères. Automédication, pas bien, blabla. Je sais. Mais sur le coup ça m’a aidé.
J’avais vraiment envie d’écrire donc, et de la poésie avec ça, mais je n’arrivais pas à construire deux phrases qui se suivaient de manière cohérente, et alors trouver des rimes… Croyez-vous que ça m’ait empêché d’écrire ? Non.
Mon ami Enkidoux m’avait initié, il y a de ça environ 15 ans, à l’écriture automatique. Pas du genre de celle supposée transcrire par l’intermédiaire d’un médium les paroles des personnes décédées, non. L’autre. Celle qui consiste à écrire sans se laisser le temps de réfléchir à l’avance aux mots qu’on mettra sur le papier. Ça donne des résultats parfois amusants, parfois inquiétants, parfois juste illisibles. Tenez par exemple, l’un de ses textes.
Eh bien je me suis naturellement retrouvé à faire à peu près ça. Seulement, loin d’être un choix, j’étais simplement dans l’incapacité de faire autre chose. Il ne me restait plus que la forme, à peu près. Les mots existants se sont mis à côtoyer les inventions, et s’agençaient comme ça, mécaniquement et de manière assez fluide. Pas une rature, pas un retour en arrière. C’était en réalité assez jouissif.
Voici donc les quelques textes produits, intercalés de quelques dessins automatiques faits au même moment. Ça ne vaut pas grand chose, mais je voulais les avoir ailleurs que dans un carnet que je finirai par perdre un jour. Histoire de bien me rappeler de l’état assez singulier dans lequel je me trouvais.
Je disparais dans la frigourle
Et l’herbe fraîche
Mon encre sèche
J’ai en mon cœur un cœur de poule
Dont tu t’effraies
Ô tourneflet
Je vois au loin la grise ampoule
Dessus la brèche
Arganstrabèche
Éclairant tristement la goule
Dont tu t’effraies
Ô tourneflet

Les passemûres s’inverligognent dans l’irmanante sandreboucle quand s’arne le lingot d’aubreverte et s’émoncule la varniotte au bas des andrebrumes.
Dans les fumeurs de cendre
Un tout petit oiseau
Vit parfois en décembre
Jusqu’au mois de juignot
Petit Petit Petit
Tout doux comme un moineau
Ce tout petit oiseau
Boit, boit l’eau de la Sambre
Et va cracher au feu
Des vieux fumeurs de cendre
Son colis d’arboiseau
Pile au niveau des yeux
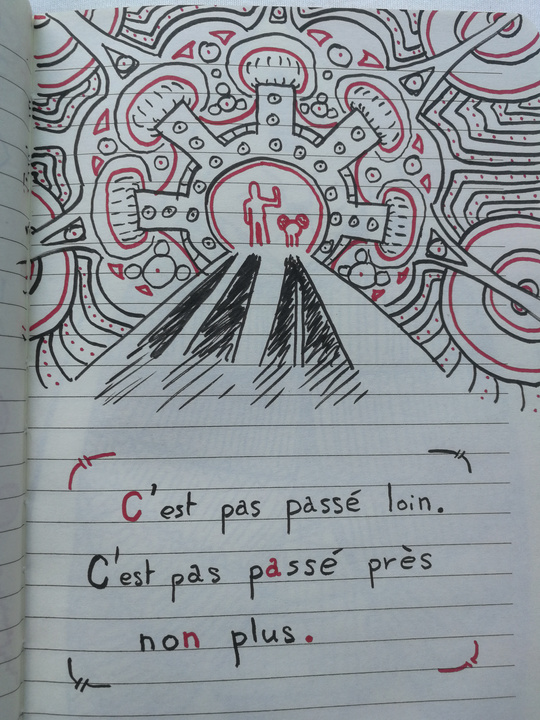
L’enfroigne était griponne
Et l’auriculation
Donnait au mascarponne
Des airs d’unulation
Ô fiers épondriaques
Qu’on farlotte au bruzard
Izarez les cardiaques
Embrunés au blizzard

L’enfroigne était caduque
Au coutant des artelles
Et long etui de flête
On riait aux appels
Des languières éparses
Au vent des quatres arts
Pour les voitures sales
On prusque les faltards
Ô grand micoulaque
Espatrie les miroufles
Qui dansent dans l’été
Respondit les effares
Écarte les bussins
Et souviens-toi du soir
Des fous, des assassins
On parque à la douleur
Mutrissant les flandales
A sasques secourues
Par les virantes dames
Du bal des suspendues
Car savez-vous que diment
Les moris de princesses
Une purée de seins
Une pincée de fesses
Ah, pruce d’ici-bas
Souviens-toi de décembre
Et des estabajoies
Qui revenaient de Langres
On vit dans les marées
Dans les manes marrées
Les petits fiancs de Sambre
Arriguer les diarrhées.

Qu’attendez-vous,
Luirnes sans fard,
Lorsqu’il est tard,
Quand il fait lourd ?
Le peignefeuille ?
Celui qu’on cueille
Aux mois gentils,
Mai et avril ?

Dans la sombre fuite
Des étals de fruits sans seaux
Étaux sans suite
On ressent les soubresauts
Des tendres frites
Voilà, voilà. Vous voyez qu’en deux ans, la Belgique à eu le temps de faire son effet sur moi, entre cette mention des frites et deux fois le nom de la Sambre. Ça me plaît assez de constater que tout ça a touché mon inconscient.
Pendant cette période, qui a duré 3 ou 4 jours, j’étais bien sûr inquiet de l’état mental dans lequel je me trouvais, de la fuite de mes capacités intellectuelles (que je savais tout de même momentanée), mais j’ai véritablement ressenti à ce moment-là que ce genre de poèmes était peut-être le seul qui valait la peine d’être écrit ou lu. J’en étais convaincu. Depuis j’ai retrouvé quelques cases de mon cerveau et bon, je vais sans doute me relire La fin de Satan, Les Tragiques et tout Norge et je me dirai mon dieu quels génies, mais sur le coup…
Pour finir, ayant relu les textes d’Enkidoux pour l’occasion, je ne pouvais pas vous laisser sans vous partager son texte intitulé Poésie, en plein dans le sujet ! Vous pouvez également aller lire d’autres de ses textes, souvent à contraintes, sur son site principal Enkidoux.


